
Ah là là … Le terme qui fâche… CertainEs tournent autour (extrême droite française), d’autres l’assument (La France Insoumise, Steve Bannon, l’AFD en Allemagne). Et personne ne sait de quoi on parle. Ou en tous les cas, ce qui est certain, c’est que personne ne met la même chose derrière.
Aussi l’idée de l’Académie était excellente : offrir un cours académique, long, historique et fouillé sur le sujet. Steven M Van Hauwaert est celui qui a relevé le défi.
PhD à Science Po, basé à Londres, il étudie le concept depuis plusieurs années. Avec rigueur. Au passage n’hésitez pas, pour les intéresséEs, à naviguer sur sa chaîne You Tube où il met à disposition plein de contenus gratuits de grande qualité, dont ses cours ! Je tiens aussi à disposition notre cours (en anglais malheureusement) si certainEs le veulent (mp svp)

Alors je ne vais par parcourir toutes les définitions structuralistes, économiques, stratégiques, socio-culturelles ou encore « idéationnelles » (je sais pas traduire « ideational ») que nous a données Steven. Je vais juste relater 2 élements phare qui m’intéressent dans le contexte franco-toulousain :
– Laclau/Mouffe : quand la France Insoumise se revendique populiste, ça grince des dents chez certainEs. J’en ai parfois discuté avec les personnes qui sont au cœur de la popularisation de ce terme au sein de la FI et j’ai trouvé une hauteur de vue avec la filiation revendiquée avec les travaux de Laclau et Mouffe. Le cours m’a permis de positionner cette vision et ce que j’ai lu d’eux deux dans le contexte global du champ du populisme. Et je comprends mieux maintenant les camarades insoumisEs qui revendiquent leur approche populiste liée à ces 2 penseurs. Steven nous a décrit cette vision comme résultat de l’observation, dans les années 1980/1990, d’une forme de consensus politique mou autour du libéralisme (il prend l’exemple de la vidéo de Blair faisant l’éloge de Thatcher comme une « grande dame » lors du décès de cette dernière), consensus qui a, selon ces 2 penseurs, affaibli la démocratie.
L’élection présidentielle, intervenue 2 mois après le cours, illustre, en France la finalisation de cette déstructuration du paysage politique français autour du pôle libéral incarné par Emmanuel Macron, que certains dans la FI, comme François Ruffin, désigne sous le nom de « extrême centre » ou « extrême argent« , pour bien marquer que ce n’est plus le « centre » historique français « modéré ».
Laclau et Mouffe ont donc affirmé, face à cette évolution, la volonté de ramener un conflit pacifique (sur le plan des idées) dans le champ politique pour le bénéfice du peuple et de la démocratie. Le populisme serait alors un discours, une volonté que quelqu’un devienne « l’avocat du peuple » pour le bénéfice de la démocratie.
Steven porte un regard critique sur cette définition, la qualifiant de discours performatif, focalisé autour de l’ « offre » (ce que je veux « vendre » au peuple) et pas de la « demande » (pas de caractérisation de ce que recherche le « peuple » chez Laclau/Mouffe selon lui). Il lui préfère donc l’angle « idéationnel » décrit plus bas.
Je m’arrête là, le sujet est très complexe et conflictuel à « gauche » mais je comprends l’intention initiale de la France Insoumise de lutter contre le brouillard socio-libéral, enfonçant dans la léthargie politique. Il y a une vraie fondation idéologique dans le rattachement aux travaux de Laclau, qui se détache malheureusement (pour la compréhension aisée de leur discours) de celle qui émerge dans le champ académique (selon Steven). En tous les cas on ne peut pas balayer d’un revers de mains dédaigneux cette référence, comme le ont parfois d’autres collègues toulousainEs.
Quelle définition prendre donc ? (la piste « idéationnelle »). Steven nous amène au bout de 2h sur ce qu’il considère comme la définition la plus fréquente dans le domaine des sciences politiques actuelles et se réfère ainsi à HAWKINS (2009) pour qualifier le populisme comme une ensemble d’idées / idéologie (par opposition à une stratégie, cf ci-dessus, ou un discours) « qui voit la politique comme un combat entre la volonté du peuple et une élite qui conspire contre lui, associé à un appel à un changement systémique » qu’il complète par MUDDE (2004) en décrivant la séparation en 2 de la société que promeut le populisme entre « des camps homogènes et antagonistes, les « gens purs » et « l’élite corrompue » », Mudde décrivant que le populisme prône que « la politique devrait être une expression de la volonté générale du peuple »
Ainsi le populisme serait organisé autour de 3 grandes composantes :
o Le peuple
o L’élite
o La volonté générale comme un absolu
Il peut être ainsi défini comme l’antipode de l’élitisme/technocratie (ex : Mario Monti) et du pluralisme (ex : Obama dans ce qu’il défend sur la discrimination positive et la défense des minorités). Il cache quelque part une forme d’approche moraliste (bien/mal, avec « nous » contre « eux »).
Steven mentionne qu’il n’y a a priori pas de lien avec la démocratie participative, le populisme pouvant accepter la démocratie représentative, c’est-à-dire un gouvernement et un chef, s’il est l’émanation des « pure people ». Il n’y aurait donc selon lui pas d’hypothèse à formuler, académiquement, sur le fait que le populisme soit « bon » ou « mauvais » pour la démocratie.
Il conclut en disant que cette approche de définition du populisme a des bénéfices importants car elle permet :
o La caractérisation la plus claire parmi les approches du populisme
o De caractériser la « demande » (qu’est ce qu’un citoyen populiste ?) ce que ne permettent pas d’autres approches focalisées sur l’offre (approches discursives ou stratégiques)
o D’analyser l’échiquier européen assez aisément.
Alors, en cherchant pour chaque candidatE à la présidentielle française l’ « élite corrompue » qu’iel pourfend, saurez-vous caractériser les mouvements populistes ?
A vous de jouer.


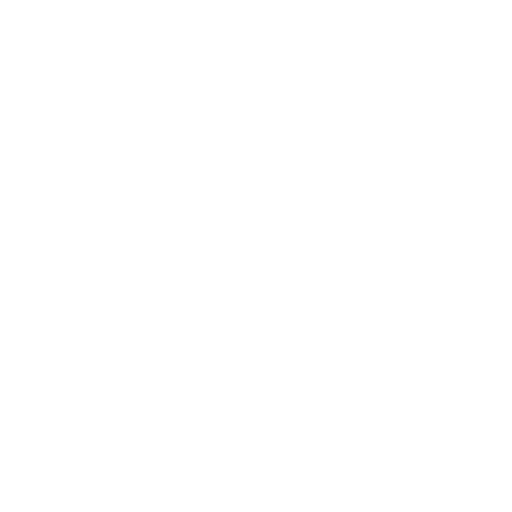

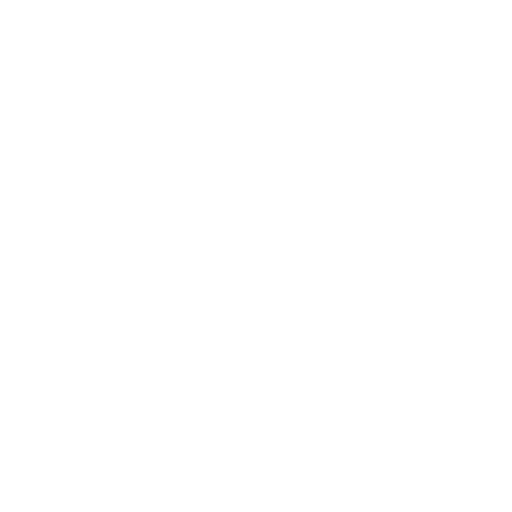





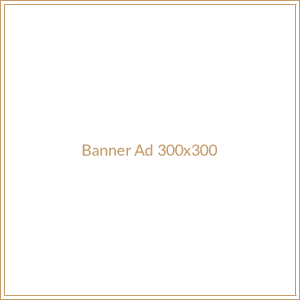
Laisser un commentaire